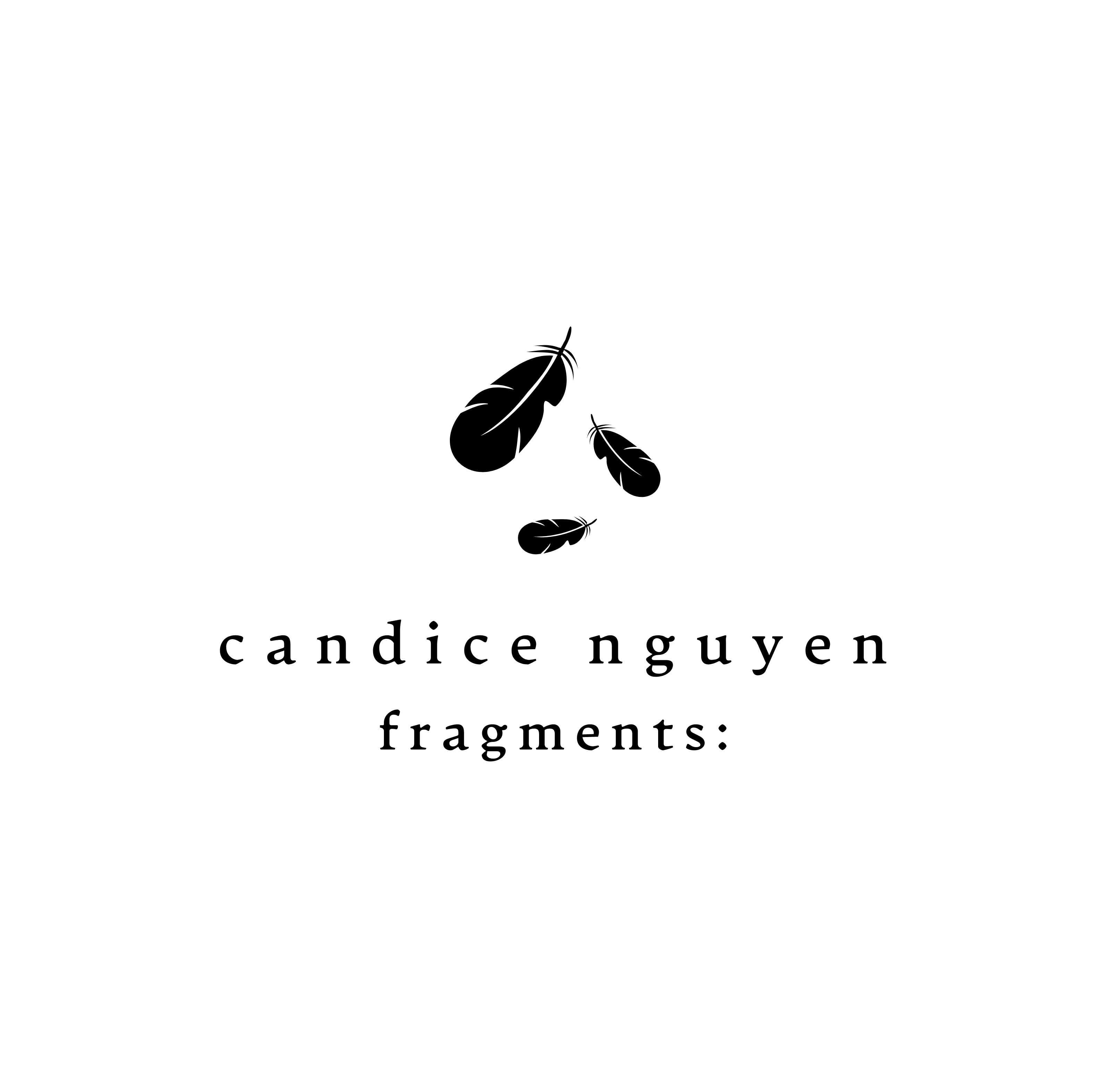Carnet tangérois
« Et nous, nous aimons la vie autant que possible. Nous dansons entre deux martyrs. Entre eux, nous érigeons pour les violettes un minaret ou des palmiers. Nous aimons la vie autant que possible. Nous volons un fil au vers à soie pour tisser notre ciel et clôturer cet exode. Nous ouvrons la porte du jardin pour que le jasmin inonde les routes comme une belle journée. Nous aimons la vie autant que possible. Là où nous résidons, nous semons des plantes luxuriantes et nous récoltons des tués. Nous soufflons dans la flûte la couleur du lointain, lointain, et nous dessinons un hennissement sur la poussière du passage. Nous écrivons nos noms pierre par pierre. Ô éclair, éclaire pour nous la nuit, éclaire un peu. Nous aimons la vie autant que possible. » Mahmoud Darwich, Plus rares sont les roses, "Nous aimons la vie autant que possible"
12 octobre, au matin. de Marseille à Tanger.
Madame Laila, c’est ainsi qu’elle se présente la première fois à moi en notant dans mon petit carnet noir ce nom tel quel avec un numéro de téléphone. tu n’auras pas besoin de prendre un hôtel la prochaine fois. viens à la maison, tu es la bienvenue chez moi. viennent se rajouter en bas de ses coordonnées le nom d’une place à visiter écrit en arabe et sa transcription en français, Marara Herkal (elle me dessine alors la carte de l’Afrique, ne retrouvant plus le mot « afrique » dans sa mémoire, me pointe l’emplacement du Maroc et de l’Égypte de son doigt et me dit : c’est ça que tu verras là-bas).
je note à mon tour le nom de quelques villes situées dans un périmètre de 100 km à la ronde où je pourrais éventuellement me rendre au cours de mon séjour. Tetouan, Asilah, Chefchaouen. Chefchaouen évoqué la semaine dernière à Marseille par A. avec qui j’avais passé un mois de navigation le long de la côte ouest groenlandaise l’an passé et qui m’en a vendu les attraits – pas que pour sa réputation liée au chichon.
Laila, on s’est rencontrées dans l’avion. je n’avais pas dormi (ou très peu, une heure et demi ou deux au max) et l’heure matinale de mon vol tapait sur mon crâne et mes paupières. assise côté hublot dans une rangée de trois, Laila prit place à côté de moi accompagnée d’une petite en bas âge qu’elle installa entre nous deux. je tentais de rattraper un semblant de nuit avant d’arriver à Tanger mais c’était sans compter les petits pieds de la minuscule Jahida qui vinrent en maintes reprises me réveiller. la troisième fois, je proposai à Laila d’échanger nos places pour que la petite se retrouve côté hublot et moi côté couloir afin de pouvoir dormir enfin un peu (beaucoup abusé de mon capital santé ces derniers jours, le corps ne sait pas se raconter des histoires contrairement à la tête qui y parvient très bien). finalement, nous nous mîmes à discuter quasiment tout le trajet, de sa famille, de son travail, du Sud la France et de Tanger, et c’est ainsi que je revis Laila tout mon séjour tangérois.
L’avion posé, j’aide Laila à se dépatouiller d’avec ses bagages, poussette et petite sous le bras. une pluie drue achève de refermer mes yeux sur le tarmac. passée la douane, alors que j’allais prendre un taxi, Laila me retient, mon mari va t’emmener jusqu’au centre-ville, ne dépense pas de sous pour rien. et c’est ainsi qu’Hamid fit son apparition, les yeux rieurs, la bonhomie et la gestuelle maladroite et heureuse fortement communicatives.
Nous montons dans son kangoo et déposons d’abord Laila et la petite chez eux, ils habitent non loin de l’aéroport. Laila en profite pour me donner une miche de pain marocain tout juste achetée à la boulangerie du coin (bon bon d'accord je prends). j’attends Hamid dans la voiture le temps qu’il l’aide à monter tous les bagages poussette et enfant dans leur appartement et me dis que ce pays a un sens de l’accueil assez rare et que putain que ça fait du bien au cœur. je pleure de rage et de honte à la pensée de mon pays et de notre vieille et rance Europe. mon projet initié en Arctique autour de cette quête permanente de lumière trouve ses échos en chacun des pavés que je foule et semble de façon alarmante être devenu le fond quotidien dans lequel j’essaie tant bien que mal de rajouter simplement au jour le jour qui est. Hamid remonte dans la voiture et m’accompagne alors jusqu’au centre de Tanger dans le quartier de Nejma où j’ai loué un appartement à quelques mètres de l’eau.
12h30. Tanger, rue de la Sena.
J’attends Rachid qui doit me remettre les clés de l’appartement. un grand mec arrive. un beau mec même. mais une tête pas très commode mais alors pas du tout même, du genre racaille avec le fond des yeux emprunt de noirceur et le regard à la fois paumé et violent – ou défoncé. quelque chose à la Cassel. il me montre l'appartement, me présente le chat et sa façon de boire au robinet de la salle de bain qu'il laisse couler. petit moment étrange de flottement. Rachid ne parle pas français. moi pas arabe. on baragouine en espagnol le temps de ce tour du propriétaire. je pose mon sac et moi-même sur le canapé. m’endors deux bonnes heures complètement rétamée par la fatigue. le réveil est difficile, le corps douloureux, ma notion de l’espace-temps complètement en vrac. je sors aux alentours de 15h30 et emprunte l’avenue qui longe le littoral en direction de la médina. puis à un embranchement, grimpe des escaliers remontant vers je ne sais où.
17h. 37 rue de la Casbah.
Par deux fois en ce premier après-midi ici, sans que je n’ai de carte ni de visualisation mentale, ne serait-ce que sommaire, de la topographie de la ville, mes pas me portent directement aux bons endroits i.e., une fois n'est pas coutume, aux endroits vers lesquels j’avais le désir préalable de me rendre (c'est que je me déplace toujours sans plan — de ville ou de vie ; c'est d'ailleurs parfois fatigant) : à la librairie des Colonnes tout d'abord, j'y cueille là deux livres bilingues français / arabe d’Omar Khayyâm, le numéro 8 de la revue Nejma consacré à la colère ainsi que les Lettres de Tanger à Allen Ginsberg de William Burroughs ; puis au sortir du dédale de la médina, au 37 de la rue de la Casbah où se trouve la (très) charmante petite adresse indiquée dans un article paru dans le Monde la semaine passée : le Café à l’anglaise — avec ses femmes magnifiques qui le tiennent.
Bien installée depuis le fond de mon canapé rétro aux coussins moelleusement dépareillés, je commence à peine à me réveiller de la torpeur de ma sieste et commande un jus d’orange (très doux) et des samossas aux épinards que je mange lentement avec le fond de menthe fraîche disposé au fond de l'assiette. personne d'autre dans le petit salon de thé-restaurant-café que moi et ses trois femmes qui préparent le dîner du soir. je consulte mes messages et me plonge dans la lecture d'Omar Khayyâm.
« Toi, qui de l’univers en marche ne sais rien,
tu es bâti de vent : par suite, tu n’es rien.
Ta vie est comme un pont jeté entre deux vides.
Tu n’as pas de limite, au milieu tu n’es rien. »
—Omar Khayyâm, Quatrain n°4
La nuit est tombée et il fait si bon dans le petit Café à l'anglaise que je commande un couscous végétarien — potiron, chou, courgette, patate, carotte — aux mille saveurs et à la semoule parfaitement cuisinée (c'est-à-dire que chaque grain demeure grain et non pas se transforme en une masse collante). je demande du harissa, un temps d'arrêt dans le regard de la jeune femme qui finit par me tendre du Sriracha. entendons-nous, il n’y a de pire affront pour les papilles que de confronter les subtiles saveurs orientales de ce couscous si raffiné avec celles industrielles extrême-orientales. ma gorge déglutit un blurps en voyant apparaître la vilaine bouteille en plastique de faux piment ketchupisé tandis que deux tables de clients arrivent : j'ai l'impression déjà, de faire partie des meubles et mille bibelots et breloques qui composent la pièce.
Redescendue au bas de la place du 9 avril, j’achète des petites oranges vertes et grenades pour quelques dirhams. pas l’air de vouloir entuber les gens ici : le monsieur me retient par le poignet pour me rendre plus de monnaie encore et me rajoute quelques oranges dans mon sac. je rentre sur les coups des 21h30 à l’appartement et découvre le contenu de la revue Nejma. absolument fabuleux. tellement fabuleux que je n'éteins les lumières que passé minuit malgré la fatigue et passe la nuit sur le canapé. le canapé.
13 octobre, 10h20. Tanger, rue de la Sena.
Réveil dans un corps atrophié qui présente un manque absolu de forces. la petite chatte Farida que je suis obligée de me farcir tout le séjour – livrée avec l’appartement loué – est surexcitée. je l’enferme tantôt dans la cuisine tantôt dans une autre pièce selon où je me trouve. trop d’hystérie : très peu pour moi. je hais les animaux domestiques et n'éprouve de culpabilité à entendre le chat hurler à la mort. plutôt un profond agacement. la petite Farida est pourtant bien mignonne avec sa taille miniature et son petit bandana rouge accroché comme une antifa autour du cou.
la gazinière ne marche pas, pas moyen de se faire un café. je descends de l’appartement et file prendre mon café en bas de l’immeuble au Tropicana Café. s’abattent de lourds rideaux de pluie tandis que je continue la lecture de la revue Nejma, relevant parfois la tête vers les immeubles d'en face dont la mocheté font tout le charme, ici et maintenant, alors que le ciel est maussade et la mer grise. il y a un an jour pour jour, V. s’éteignait. j’entends encore G. me disant : il a attendu que je m’endorme. il devait être un peu avant six heures du matin. pour le reste, j'ai oublié je ne sais combien de pans, la plupart des choses même, de cette étrange période que nous avons partagée entre septembre et novembre derniers.
c'est une alliée farouche du courage et de la vertu. »
Place Sour Meêgazine
« Détestable ou saine colère, est-ce le même fil qui tisse les longues écharpes nerveuses ?
La colère est une courte folie, un fragment vivace dans le temps, une déchirure. Elle est un éclat, un instant d'éclat.
Dans ce recueil de variations sur la colère – thème qui nous tient à cœur tant elle est aussi un élément moteur de l'expression artistique –, nous affirmons encore une fois, notre engagement et notre exigence en littérature. Nous exprimons, à travers ce florilège, notre colère, ou plus précisément ce que je considère être notre propre colère, un sursaut de vie au milieu de l'asphyxie et qui, toujours, redonne place à l'humanité. Elle me semble ici le mieux définie par le vers de Lucie Land « Rien ne s'apaise, tout devient chant ». Cette même colère nous anime dans notre combat quotidien pour la diffusion du livre, l'édition et la libre expression de la littérature.
Il est une saine colère, qui fait demeurer l'homme debout, merveilleusement illustrée dans les événements de ces deux dernières années, qualifiés de printemps arabe, et cette volonté des peuples – bien au-delà du Monde arabe, à s'exprimer d'eux-mêmes. Et dans son sillage, en miroir déformant, la colère des armes, cette folie des hommes, qu'elle soit du Rif avec le récit tragique de Mohamed Mrabet publié ici, ou de Syrie sous les bombes où Ahmad Basha, d'une cave, a ciselé le poème de son propre courroux, littérature souterraine qui reprend vie dans Nejma, de l'autre côté de la Méditerranée. (...)
Le lecteur appréciera également la présence d'écrivains, de sociologues, de poètes, d'anthropologues, de dramaturges, cinéastes et plasticiens, qui nous offrent une approche plus explicite et apaisée de la question. Et quand la colère prête l'oreille à la raison, c'est une alliée farouche du courage et de la vertu. » Simon-Pierre Hamelin, Nejma n°8, Editorial
12h23. Café du cinéma le Rif.
Fièvre plutôt forte. état de mes neurones pire que les pires soirées de défonce. en regardant les banquettes noires en skaï et tables rouges en formica, le souvenir de mes années estudiantines passées dans les troquets du XVIIIe arrondissement de Paris ou de la rue Keller. l’homme en face de moi est concentré sur une petite introduction aux dialogues de Platon, et Cabrel de tourner en boucle dans le café du cinéma sur fond de machine à café qui turbine. je laisse Max Richter dans mes oreillettes adoucir l'attentat que provoque Francis dans mon être et contemple par la baie vitrée la place du 9 avril, ses gens qui la traversent et la pluie qui tombe doucement. mes mains tremblent. terriblement. ce n’est pas maintenant que je m’entraînerai à la calligraphie arabe. alif ba ta tha et cetera. est-ce que ce monde est sérieux. Cabrel quoi. je réajuste les écouteurs sur mes oreilles et remonte le son du petit appareil mp3.
(assurément non qu'il n'est pas sérieux, si tu veux que je te réponde. tout cela n'est qu'une vaste de blague, une longue et douteuse blague. la preuve en est : ces années qui passent et mes pas qui déambulent d'une ville à l'autre, d'un continent à un autre, sans avoir encore rien compris de comment les gens arrivaient à comprendre la moindre chose ici bas. ou peut-être qu'ils font semblant, ce qui me semble encore plus inutile et une perte de temps plus incompréhensible encore.)
De l'étrangeté de me percevoir ici à l'instant présent regardant la place du grand souk tout en ayant mes pensées à Paris lorsque, la veille de la mort de V., je publiai une photo depuis la fenêtre de chez A. légendée « farewell good night », sans savoir encore que ce serait bien à la fin de la nuit qu'il nous quitterait. et moi de m'affairer le lendemain à mille et un rendez-vous de travail et amicaux et de clore cette journée en apesanteur par une représentation de la dernière mise en scène de Luc Bondy à l'Odéon... cours ma fille cours, il sera toujours temps de pleurer. (j'avais quitté la salle néanmoins avant la fin de la pièce, traversé l'île de la cité, pour aller boire un verre chez un ami. d'alcool fort je suppose à rebours.)
« Ceux qui croient que l’art et la littérature sont des actes désintéressés au service d’une esthétique n’ont rien compris. Il n’y a pas plus politique qu’un roman ou un tableau.
(…)
A cet instant, il aurait souhaité [il, c'est Bouazizi] que la terre lui ouvre ses entrailles pour lui donner refuge contre cette humiliation. Il reprit ses esprits puis s’éloigna en silence. »
—Youssef Belal, « La colère des mots » in Nejma n°8
Sur les murs, une couverture jaunie de Paris Match avec une pin up à la Marilyn. « Le cinéma va-t-il disparaître ? ». au plafond, des luminaires ronds aux couleurs pastel tombent en cascade comme la pluie au dehors, en face de moi un vieux miroir en tain rongé par le temps en ses bordures. français, anglais et arabe se côtoient dans un léger brouhaha et la fumée des cigarettes remonte la verrière qui longe le long bar. la lumière commence à percer et le ciel un peu plus clair.
14h32. dans la Casbah.
Place du Méchouar, assis avec un ami sur des marches à quelques pas du musée de la Casbah, Abdoul m’interpelle et se met à me parler tranquillement en arabe. euh… ismi candice, voilà les seuls mots que je peux lui sortir pour le moment. je n’ai absolument rien compris à ce que tu viens de dire. ah. il me la refait en français. si tu cherches le musée, l’entrée est derrière toi, tu viens de le passer. il me croit marocaine. non je ne veux pas aller au musée, pas maintenant en tout cas. je veux aller voir la mer. il se lève et m’accompagne. de sa voix douce, son flow rapide et ses yeux de chat (je pourrais tomber amoureuse en une fraction de seconde), il m’indique les points touristiques autour de la citadelle, quelques éléments d’histoire. ici c’est ceci et c’est parce que cela, là tu as ça, et il y aussi ça et ça et ça, et le marché berbère de mon oncle si tu veux aussi, et cetera. je lui dis que je vais rester un peu là à contempler le panorama, que je rentrerai dans la Casbah plus tard et repasserai par la place où nos chemins se sont croisés. il disparaît aussi doucement qu’il m’est apparu.
Sortie Nord de la Casbah.
Quatre chats errants et lascifs sommeillent derrière moi et se câlinent tandis que nous sommes quatre hommes assis sur le petit muret surplombant la mer à regarder la délimitation entre l’Atlantique et la Méditerranée, à rêver mille choses face au continent opposé qui s’étale ostensiblement sur la ligne d’horizon à quelques kilomètres de là seulement. opposé vraiment ?
qu’on tente de se représenter le temps où la Méditerranée n’était qu’un vaste désert de sel chatouillé par les fleuves, puis le temps où elle fut submergée par les eaux de l’Atlantique et après encore, celui où elle s'en est retournée à l'état d'une énorme gorge asséchée et torride n’ayant rien à envier aux canyons de l’Ouest américain.
du détroit de Gibraltar et de Tarifa :
cette Europe qui semble si proche, si proche…
combien de personnes noyées entre ses bras ?
déstabilisant le vertige ressenti ici
depuis le petit muret sur lequel nous sommes assis.
la fièvre est passée et la lumière crue.
(nota : la fièvre a du bon dans l’errance et ses divagations)
De retour dans la Casbah.
Je suis repassée par deux fois devant le musée de la Casbah sans faire exprès. quel dédale ces médina. un homme en djellabah me demande avec beaucoup de sympathie si je vais bien. oh oui très bien merci. et il poursuit sa route avec un petit sourire en halo autour de sa tête. j’aperçois le garçon qui était avec Abdoul assis toujours sur les mêmes marches et lui demande alors où se trouve le fameux petit marché berbère de l’oncle. je m’y rends. beauté de la blancheur et de la lumière qui tombe sur les pentes des rues alambiquées. des chats paressent encore, ici et là, mais le champion est celui qui s’est affalé au beau milieu d’un croisement de rues sur le petit carré de soleil qui traînait.
À son magasin berbère, dans la Casbah.
Shalabia – El Helwa De (الحلوة دي)
Il est assis sur une petite chaise en plastique à droite de l’entrée du magasin. c’est l’oncle berbère je suppose. cinq étages ? six ? un toit terrasse avec une vue panoramique à couper le souffle. dommage qu’il y ait des hommes jouant du marteau-piqueur au moment où je m’y rends, j’aurais passé mon heure à y boire un thé à la menthe en scrutant les moindres toits de la médina depuis là. ça me rappelle un de mes premiers chocs esthétiques quand je suis arrivée à Marseille pour m’y installer. je recherchais un appartement et enchaînais alors les visites d’un quartier à l’autre de la ville. dans une petite rue du Panier un jour, depuis le quatrième étage d’un immeuble vétuste et humide, l’agent immobilier m’avait menée sur le toit me disant que je pourrais faire usage de la terrasse – qui n'était absolument pas sécurisée soit dit en passant : pas de rambarde, en pente et sur fond de tuiles douteuses, ah Marseille ! – mais quel choc avais-je reçu alors en découvrant le 360° qui s’y offrait, d'une insolence parfaite, sur la mer, la Côte bleue, les toits et toute l’étendue de la ville du Nord au Sud en balayant ses moindres flancs Est.
Je discute avec Ahmed, d’ici, de Marseille, il me dit, lui aussi, que ma tête est marocaine – j’en présume : ma tête d’émigrée, bronzée et seule à me balader ainsi, passant incognito en somme dans un peu n’importe quelle ville aujourd’hui – il se met alors à comparer la peau tannée de nos deux poignets. tu vois, on a la même couleur.
Je lui prends trois petits porte-monnaie et un porte-feuille en cuir, une grande bague. alors que je suis sur le départ, Ahmed me dit : on se reverra. l'intérieur de ma tête répond inch allah tandis qu'un homme le prononce à haute voix pour moi. l’impression de frontières floues entre rêve et réalité, entre intérieur et extérieur. je ne sais pas d’où cet homme a surgi mais il est clair qu’il vient seulement d'apparaître dans le tableau. l'homme me raccompagne dans les étages (la bâtisse est quelque peu immense) tout en me parlant avec emphase… en arabe encore. je le vois gesticuler dans les escaliers, me regarder, sourire, parler, je n’ai encore rien compris, et lui semble n’avoir pas compris que je ne comprends pas un brin d’arabe, à part les quelques mots rentrés dans le langage courant en France. on n'ira pas très loin juste avec des walou kif kif chouïa rouya la smala et cetera.
Au premier étage, je recroise Abdoul qui semble bien content de voir que j'ai trouvé seule le chemin jusqu’ici. quel tempérament posé de douceur – même réflexion que précédemment : ah ces yeux de chat. j’aime ici qu’on n’agresse ni ne harcèle pour vendre ceci ou cela. la parole qui s’engage est un brin curieuse (de l’autre), toujours respectueuse et douce.
15h26. dans la Médina.
Je m’arrête rue de la Marine prendre un thé à la menthe à la terrasse d’un troquet dont tous les guéridons et chaises s’alignent face à la rue. il n’y a que des hommes du quartier installés de part et d’autre de mon guéridon. la pluie vient de reprendre, immense
RIDEAU
(c’est ce qui est écrit dans mon petit carnet noir,
seul en plein milieu de la page suivante)
Derrière, les rues du souk sont pleines de hordes de touristes et d’échoppes attrape-touristes. devant : la beauté de l’averse lumineuse et de l’agitation humaine qu’elle provoque. les enfants cartable sur le dos hurlent de plaisir, les hommes se réfugient sous quelque auvent, les femmes continuent de parler tout en interpellant leur progéniture. il y a par intermittences une grande agitation dans les rues puis plus rien que le grand calme, reproduisant les aléas d'une météo lunatique où le ciel s’amuse aux caprices éclatants.
Ce que j’aime dans le fait de voyager seule : ce temps que l’on peut prendre pour laisser le venant venir, l’écoute se faire et la contemplation dérouler ses petites pelotes aux fils intriqués. par-dessus tout aussi, et finalement comme partout ailleurs et en tout temps lorsqu'on arrive à laisser les vannes ouvertes : se laisser le temps de recevoir les rencontres. de l'importance du vocable et de ce mot recevoir. il est bien loin enterré mon parisianisme, Marseille a cette force de vous apprendre à ouvrir les vannes pour laisser le monde rentrer en vous.
« Il faut balayer devant notre porte et commencer par là (…). »
Driss Chraïbi in Revue Nejma n°8
Je constate avec étonnement que les deux tables à côté de moi, désormais toutes occupées par des touristes, n'arrêtent pas de se faire alpaguer par quelques vendeurs à la sauvette (enfin il n'y a rien d'à la sauvette dans le cas présent), tandis que je suis épargnée depuis bientôt une heure. pourquoi à ma gauche, pourquoi à ma droite, et pourquoi pas moi ? de mon don d'invisibilité. c'est en quelque sorte un ijtihad, un effort permanent de se fondre dans la masse. et je revois mentalement Ahmed comparant la peau tannée de nos deux poignets.
pareils, le sommes-nous vraiment ?
16h30. même terrasse, dans la Médina.
Abdelaziz vient de repartir avec son groupe de touristes anglophones. il est guide. il m'a demandé s'il pouvait s'asseoir à côté de moi et nous avons discuté littérature, tourisme et printemps arabes. Nejma, Driss Chraïbi, Fatima qui écrit sur la condition des femmes. le café Hafa en hauteur derrière la Casbah auquel je n'ai pas encore pris le temps de me rendre, le café de Paris à l'angle de la ville nouvelle en face de la maison du couturier qui, pour lui, ressemble en tous points aux troquets parisiens avec leur service effectué par de vrais garçons de café.
Je lui demande pourquoi j'échappe aux marchands de tapis depuis une heure tandis que les touristes qui m'encerclent commencent à s'en agacer. il me répond en riant parce que tu as un livre dans les mains. la voici donc l'arme redoutable du pauvre ! l'intellectuel est fauché ! c'est mondialement reconnu. Abdelaziz a fait des études de philologie et de littérature allemande à Fès. il s'est rendu plusieurs fois en France, notamment à Nantes et Juvisy.
Je lui demande s'il y a beaucoup de touristes en ce moment, trouvant qu'on n'en croise pas tant que ça ici ; enfin depuis mon arrivée, c'est le ressenti. Il me répond doucement… 30% de touristes comparés à avant mais c'est déjà bon signe pour nous, qu'on vienne passer du temps dans notre pays et qu'on veuille visiter le Maroc, malgré les printemps arabes, malgré tout ça… et le reste… c'est bon signe pour nous.
Abdelaziz à la fin de notre petite parlotte qui a bien dû durer une quarantaine de minutes, me propose de m'emmener (gracieusement) faire son tour à lui de Tanger, qu'il l'aurait fait dès à présent si l'heure n'était pas déjà ce qu'elle était et s'il ne devait pas retrouver sa petite famille à la maison. il me propose alors de se revoir dimanche prochain sur son jour de congé et me tend sa carte de visite imprimée en couleur sur du papier fin. si j'ai le moindre souci ou la moindre question, que je n'hésite pas. malheureusement, c'est dimanche que je repars déjà. une prochaine fois, me dis-je.
C'est l'heure de la prière. ça crache depuis les haut-parleurs de la mosquée. cinq femmes dont moi occupent désormais la terrasse – surprenant, et la rue s'est quelque peu vidée de ses hommes.
Cinéma le Rif. Café à l'anglaise. Avenue Mohammed V.
18h18. De retour au cinéma Le Rif, le ciel désormais bleu. au milieu de toutes les autres inscriptions présentes, je laisse un message au stylo noir sur l'une des portes des toilettes des femmes. une odeur d'épices dans la bouche, le ventre retourné et l'estomac qui me fait sentir qu'il n'a plus l'habitude de manger et que je n'aurais jamais dû prendre un messamem dans la rue tout à l'heure. en diagonale de ma table, le même mec à capuche avec son ordinateur pomme que ce matin. un homme est en train de discuter avec lui en arabe et laisse échapper en français la Maison Européenne de la Photographie — mon endroit préféré à Paris dont je parlais pas plus tard qu'il y a deux jours à Marseille.
19h24. De retour au café à l'anglaise. me force à dîner avant de rentrer malgré l'estomac toujours noué (commande un loup grillé – pas de garniture) — bsaha bien sûr. j'essaie de noter le mot en arabe dans mon petit carnet, demande confirmation à Hanane, l'une des demoiselles qui travaillent ici, et note quelques réflexions et questionnements sur cette langue que je découvre à peine.
21h. je recroise Rachid en redescendant l'avenue Mohammed V. en le voyant là, je me rends compte que c'est bien lui que j'avais vu debout sur le trottoir d'en face alors que j'étais installée à mon guéridon face à la rue quelques heures plus tôt dans l'après-midi. le personnage est vraiment sombre avec son regard fuyant et sa belle gueule. j'achète un paquet de mouchoirs pour 0,5 dirham à une dame dans la rue. si j'avais eu plus de monnaie sur moi, je pense que je lui aurais laissé le double (ce temps toujours fou à jauger les pièces de monnaie de n'importe quelle devise).